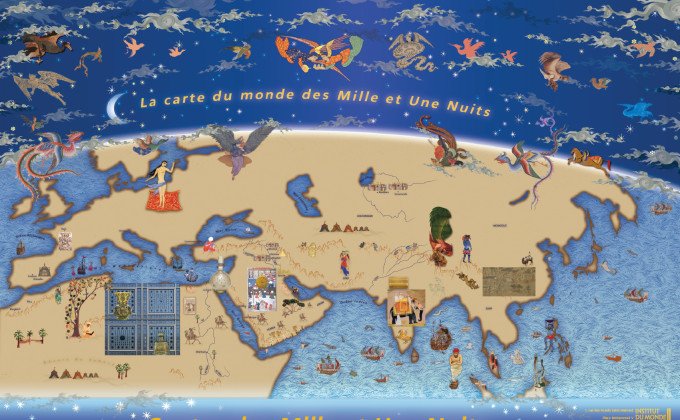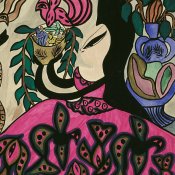« A propos de la civilisation arabe », conférence inaugurale des Rendez-vous de l’histoire du monde arabe par Jean-Claude Carrière
A propos de la civilisation arabe
Texte lu le vendredi 19 mai , à l’Institut du monde arabe par Jean-Claude Carrière, lors de la conférence inaugurale des Rendez-vous de l’histoire du monde arabe 2017.
" NOTRE MIROIR ENTRELACÉ
ou
COMMENT LE PRÉSENT TRAHIT LE PASSÉ
Le présent, le temps présent, celui que nous vivons et qui passe sans un arrêt sous nos yeux et entre nos mains, a souvent tendance à aveugler le passé. Ce passé, surtout lointain, que nous n’avons pas connu, que d’autres nous ont décrit ou raconté, le présent, les événements du temps présent peuvent assez facilement le défigurer et souvent - même sans le savoir - le trahir, et cela au moment même où nous prétendons le « représenter », c’est-à-dire le rendre présent.
Ce jeu dure depuis longtemps. Nous ne voyons le passé qu’à travers le voile déformant du présent. Toujours. Et nous ne pouvons pas le voir autrement. Tout acte de mémoire est un acte de maintenant. Et il se rapporte au passé. C’est aujourd’hui, c’est en ce moment, que je me souviens, que nous nous souvenons de ce que nous avons vécu, de ce que d’autres ont vécu hier, ou ont raconté avant-hier.
La mémoire, constamment sollicitée, toujours déforme, la nôtre comme celle des autres. Et il ne peut pas en être autrement. Elle est une faculté incertaine et fragile. Nous ne pouvons pas compter sur elle.
Nous savons aussi, de toute manière, que chaque peuple, quand il se raconte, trouve des arrangements particuliers avec son histoire, qu’il s’y donne presque toujours le beau rôle. On dit même qu’il en fait souvent un roman, qui dans ce cas s’appelle « roman national ». Et ce roman prend peu à peu la force et l’évidence d’une vérité.
Les exemples, dans ce domaine, sont multiples, et nous n’avons pas à chercher bien loin. Je n’en citerai qu’un, qui nous intéresse ici, aujourd’hui. Lorsque, dans les années 1950, je faisais des études dites supérieures d’histoire, nous avions au programme, une année, « L’Islam au Moyen-Âge ». Un professeur âgé, probablement émérite et certainement spécialisé, nous dit un jour ceci, à la Sorbonne, et je le transcris presque mot pour mot :
« Quant à la bataille de Poitiers, nous savons aujourd’hui qu’elle n’a pas eu lieu. Si elle a eu lieu, elle a eu lieu ailleurs qu’à Poitiers. Et si elle a eu lieu ailleurs qu’à Poitiers, nous l’avons perdue. »
Ainsi, une de nos dates glorieuses, gravée sur nos stèles, s’effondrait en quelques mots. Le professeur ajouta même - ce que je n’ai pas pu vérifier, pas plus que le déroulement et l’emplacement exact de la bataille, - que « Martel » était le nom que Charles avait reçu dès son berceau, et qu’il ne l’avait nullement gagné, plus tard, en frappant les envahisseurs musulmans de sa masse d’armes.
Bien entendu, il fallait atteindre un certain niveau, dans les études, pour recevoir cette révélation. Pour les plus jeunes - et pour la majorité des Français -, la bataille restait la bataille de Poitiers, la grande bataille, qui avait sauvé la France de l’invasion arabe.
Et c’est toujours ainsi, je crois, que nous l’enseignons à nos écoliers.
Avec des nuances, j’espère.
Le présent ne peut pas s’interdire de malmener le passé, et de le masquer, de le triturer, de le déguiser, sans cesse. Ainsi, les évènements des vingt dernières années, qui ont secoué le monde musulman, et qui vont des révolutions que nous appelons « arabes » à la proclamation soudaine, au Moyen-Orient, d’un khalifat islamique, avec les attentats que nous avons subis, et que sans doute nous subirons encore, et les atrocités que nous avons vues, ces évènements récents, plus encore que la fumeuse bataille de Poitiers, risquent de nous faire oublier ce qu’a été la civilisation arabe et tout ce que nous lui devons.
Ce passé a été peu à peu gommé de l’histoire, une histoire que nous avons écrite, à notre manière - et notre exemple n’est pas le seul que nous pourrions citer. Parfois nous voudrions nier des actions connues, parfois nous voudrions effacer les traces encore visibles de ce qui a été, et nous allons quelquefois, dans la négation frénétique de l’histoire, jusqu’à détruire des ruines.
Peut-être un jour, des mains furieuses effaceront les peintures de Lascaux, d’Altamira, de la Grotte Chauvet, parce qu’elles ont été faites par d’autres.
L’histoire, quand elle se raconte, travestit souvent, pour le meilleur (quand il s’agit de soi) ou pour le pire (quand il s’agit des autres), les cultures qui se sont succédé sur tel ou tel sol, sous tel ou tel drapeau. Parfois elle les glorifie (c’est le cas, en France, des vingt-cinq dernières années du siècle de Louis XIV, que nous qualifions encore de « grand siècle » alors qu’il vit un million et demi de paysans français mourir de famine - un million et demi d’habitants dans un pays qui n’en comptait alors que vingt - sans compter les cinq cents villages rasés dans les Cévennes, lors du « grand rasement » de la guerre des Camisards, incendies et galères au nom de la « vraie foi »).
Parfois au contraire l’histoire - cette activité fantasque qui change de ton et même de matière en changeant de rive, en passant un pont sur une frontière (ainsi, la bataille de la Marne est une victoire aussi bien du côté français qu’allemand) - l’histoire donc réduit, rabaisse et quelquefois anéantit ce qui fut grand, lumineux, généreux, et qui eût mérité de rester mémorable. Et je ne pense pas seulement à l’utopie de Cordoue, souvent citée, mais à d’autres périodes, souvent resplendissantes, de l’histoire du monde arabe.
Nous nous sommes d’abord regardés de loin, puis longtemps côtoyés, souvent affrontés, envahis, mais au fond qu’est-ce qui nous sépare ? Sans aller chercher bien loin, je suis natif du midi de la France, où vit une partie de ma famille, des cousins, que nous avons toujours appelés « les Sarrazins ». Et cela sans songer à les vexer, sans les mépriser, simplement parce que, à les regarder, ils auraient pu tout aussi bien naître de l’autre côté de la Méditerranée.
Et d’ailleurs, dans notre mémoire collective, comme dans nos manuels d’histoire, nous avons délibérément oublié qu’après la dislocation de l’empire romain et les invasions dites « arabes », nous avons eu un émir à Toulouse, pendant près d’un siècle.
De la même manière, nous avons oublié qu’au temps de l’Espagne arabisée, bien irriguée, qu’on appelait alors « la verte Espagne », des ouvriers saisonniers venaient chaque année de France, à pied, au moment des récoltes, cherchant du travail. La plupart descendaient du Massif Central et de ce peuple pauvre qui s’appelait les Gabaches, un peuple que cite Jules César dans La Guerre des Gaules.
De là vient le fait qu’aujourd’hui encore, en Espagne, les Français, quels qu’ils soient, sont toujours appelés « los Gabachos ».
J’ajoute que j’ai rencontré en Algérie, dans les années 1980, un écrivain et journaliste qui s’appelait Mourad Bourboun. J’espère qu’il est encore vivant et actif. Toujours est-il que son histoire m’a paru très intéressante.
Le roi Louis XIV avait un frère bâtard qui s’appelait le duc de Beaufort. Grand personnage, demi-frère du roi, ambitieux et remuant, il se vit confier le commandement de la flotte française destinée, en Méditerranée, à lutter contre les barbaresques, que nous appelions des pirates. Il fut vaincu, fait prisonnier et conduit en Algérie. Comme le roi de France refusait de payer la lourde rançon qu’on lui demandait pour son demi-frère (peut-être craignait-il aussi quelque revendication portant sur le trône), le duc de Beaufort s’installa en Algérie, très confortablement, du côté de Bône. Il y prit une femme, puis une seconde et mourut sans jamais revenir en France.
Mourad Bourboun - dans le nom de qui il est facile de reconnaître le nom Bourbon - est peut-être aujourd’hui le seul héritier légitime du trône de France, en ligne directe depuis Louis IX - ce roi qui fut le premier à imposer aux juifs de porter un signe distinctif, qui rata complètement sa première croisade, mourut près de Tunis au cours de la seconde, et qu’il nous arrive, pourtant, d’appeler encore Saint Louis.
Ce phénomène inévitable de confusion et d’ignorance, que tous les historiens connaissent - mettre le passé sous nos yeux bienveillants d’aujourd’hui - est assez bien partagé. Toutes les mémoires, de tous les peuples, y sont soumises, au point que chaque nation réécrit constamment son histoire en fonction des préoccupations du présent, et de la place qu’elle prétend occuper aujourd’hui dans le monde. Cela tient naturellement au nationalisme, à la fierté de ce que nous appelons notre « identité », à divers intérêts politiques, ou économiques, tant et si bien que l’« histoire officielle » (les deux mots pouvant être considérés comme un oxymore) n’est à la fin qu’une longue galerie de mensonges.
Et le passé n’est plus là pour nous contredire - sauf le passé des autres, qui est toujours différent du nôtre, mais que nous tenons généralement en mépris.
Cela vaut pour la France aussi bien - pour ne prendre que deux autres exemples - que pour l’historien grec Hérodote, que les Iraniens appellent tout simplement « le roi des menteurs », et pour les Chinois d’aujourd’hui, qui enseignent, dès l’école primaire, que le Tibet a toujours fait partie de la Chine, alors que le Tibet a été, en particulier au VII° et au VIII° siècles, un royaume indépendant, puissant, redouté, et qu’il a même conquis Pékin et une partie de la Chine de ce temps-là.
Il est également établi que la civilisation romaine, qui a dominé nos territoires pendant six siècles, et dont l’expansion ne s’est brisée, à l’Est, que sur le vieil empire perse, cette civilisation de juristes, de guerriers, de bâtisseurs, de techniciens exceptionnels, dont la suprématie s’étendait de l’Écosse à la Jordanie, n’a apporté à ce que nous appelons la « science » aucune découverte véritable, n’a provoqué dans ce domaine aucune avancée notable. La science antique est grecque, elle est même alexandrine, et, devant l’indifférence des conquérants romains, elle reste stationnaire jusqu’à l’arrivée des Arabes.
Ceux-ci arrivaient, il est vrai, munis d’une arme redoutable, qu’ils apportaient de l’Inde, et que les Romains et même les Grecs ignoraient, une arme mathématique plus efficace que toutes les catapultes - et cette arme était le zéro.
Grâce au zéro, qui ouvrait au calcul et à la pensée de nouvelles perspectives, et grâce à quelques esprits dévorés de curiosité, la science prit, avec les Arabes, un élan inconnu jusque là. L’arithmétique, la géométrie, l’architecture, l’astronomie et bien entendu l’algèbre - qui est même un mot arabe - connurent un nouveau départ, ainsi que la géographie, et aussi la médecine, au contact des juifs. Avec eux, une modernité s’ouvrait sur un avenir immense.
Cet élan s’accompagnait, grâce à d’habiles traducteurs, de la découverte d’anciens textes grecs, que nous transmettait une curiosité orientale aussi bien perse qu’arabe - cette curiosité qui semblait avoir compris que la transmission et le partage sont les conditions sine qua non de meilleurs rapports, sinon entre les hommes, au moins entre les hommes et le monde.
Nous avons gardé, en la plaçant très haut dans nos mémoires, le souvenir - sans doute glorifié, mais peu importe aujourd’hui - de la période de la tolérance cordouane, d’Averroès et de Maïmonide, où musulmans, juifs et même chrétiens se rencontraient, à Cordoue, se respectaient, où le « connaître ensemble » semblait la seule façon de « vivre ensemble », et où les croyances avaient la sagesse de s’effacer, pour quelque temps, devant la connaissance qui apparaissait aussi indispensable qu’indiscutable. Car les croyances divisent, alors que la connaissance réunit. Aujourd’hui encore c’est au seul nom d’une croyance, c’est-à-dire d’une proclamation invérifiable, d’une « certitude sans preuve » (comme le disait le philosophe Alain), que des fanatiques égarés massacrent - comme ce fut le cas au mois d’avril pour les Coptes d’Égypte - ceux qu’ils appellent des mécréants.
Pourquoi ces lumières arabes se sont-elles peu à peu effacées, et parfois perverties ? Pourquoi, après des siècles éclatants, une sorte d’immobilisme s’est abattu sur cette grande force novatrice ? Les raisons en ont été souvent débattues, et par les musulmans eux-mêmes, qui sont aujourd’hui horrifiés par ce qui se commet en leur nom. Et qui parviendront, nous le souhaitons tous, à revivifier cette flamme, et à redevenir eux-mêmes.
Toutes les civilisations ont traversé des périodes d’intransigeance et de cruauté. Et c’est à elles-mêmes, avec l’aide du temps, qu’il appartient d’apaiser les fureurs et de réunir ce qui s’est brisé.
Que nous reste-t-il d’une civilisation à laquelle, croyons-nous, nous n’avons pas appartenu ?
C’est difficile à déceler, et plus difficile encore à dire. Il nous reste souvent des images, que nous admirons sans réserve, en spectateurs, mais auxquelles nous ne sommes plus reliés. C’est le cas par exemple de la civilisation égyptienne, qui s’est étendue sur trois millénaires, qui s’est longuement et minutieusement racontée et représentée, dont nous admirons les structures, les proportions, le graphisme, la beauté - au point de la contempler parfois comme un décor hollywoodien des années 50 -, mais au fond de nous-mêmes, dans nos émotions secrètes, dans nos pensées, dans nos habitudes imprécises, et même dans nos croyances, que nous en reste-t-il ?
Comment le percevoir, au plus intime de nous-mêmes, et surtout comment le dire ?
Comment briser le cliché ? Comment passer de l’autre côté du tourisme ?
Étrangement, dans d’autres cas, c’est le contraire. Nous avons gardé peu de témoignages construits, concrets, et même écrits, de tel ou tel empire, de tel ou tel peuple, et pourtant, sans le savoir, nous en portons secrètement quelque chose, un sentiment qu’il nous est difficile d’identifier, qui s’est glissé en nous à notre insu, avec l’aide du temps, et qui peut-être ne nous quitte jamais. Ainsi des civilisations nordiques, que nous connaissons à peine, que nous n’étudions pas, et qui pourtant ont donné leur nom à une belle province de France, la Normandie, où l’on chercherait en vain, dans les gras pâturages et les plages élégantes, entre Camembert et Deauville, quelque trace des farouches Vikings.
Nous sommes donc porteurs, même les plus ignorants et les plus innocents d’entre nous, de bribes, et quelquefois de larges tranches, de civilisations oubliées. Ces parties de nous, qui nous constituent, qui sont notre matière et aussi notre esprit, ainsi que notre conscience, remontent sans doute à de très lointaines origines, et nous pourrions en discuter à l’infini. Nos souches poussent de racines diverses, de terroirs mélangés. Il y a du normand et de l’arabe en chacun de nous, et ils sont loin d’être les seuls.
Même les plus sédentaires d’entre nous, même les plus enracinés, ont été, un jour, des nomades.
D’autres ont élevé des pyramides, persuadés d’être quelque part pour toujours. Et leurs noms se sont effacés.
Au plus secret de nous-mêmes, nous sommes porteurs de « choses » - je ne sais pas comment le dire autrement que par ce mot -, de choses qui viennent d’ailleurs, de peuples inconnus, de mœurs étranges, de coutumes que quelquefois nous détestons au point de vouloir les détruire, de croyances obscures et compliquées qui continuent de s’entretuer dans l’imaginaire, dans l’irréel.
Nous nous affirmons ceci ou cela, moi je suis Untel, fils d’Untel, j’appartiens à la famille Untel depuis que cette famille existe, c’est-à-dire depuis très longtemps, depuis le commencement de la mémoire humaine, car il y a toujours eu des Untel, je possède toutes les valeurs et qualités de cette famille, toute sa force, toute sa mémoire, je suis un vrai Untel, j’en affiche l’identité, je me place sans hésiter au-dessus de ceux qui, autour de moi, osent se dire mes semblables, de ceux qui ne s’habillent pas comme moi, qui ne comprennent pas ma langue, qui ignorent ma culture et qui n’adorent pas mon ou mes dieux.
Nous sommes tous tentés par ce « Untel ».
Je m’arrête un instant sur le mot « identité », qui est proclamé, et décortiqué, depuis quelque temps, à tort et à travers. Il vient du latin « idem », qui veut dire « le même ». Mon identité, c’est ce qui me rend semblable, identique à d’autres.
Cependant, sur ma carte dite d’« identité », je vois marqué : « Signes particuliers ». Mon identité, c’est donc ce qui permet qu’on me reconnaisse parmi d’autres, qui me permet d’être moi-même, un individu singulier, unique. L’identité, c’est donc à la fois ce qui nous réunit et ce qui nous distingue. Autrement dit, c’est un mot qui n’a aucun sens.
Quand on lui demandait quelle serait, si on lui donnait les pleins pouvoirs, la première mesure qu’il prendrait, Confucius répondait - paraît-il : « J’assemblerais toutes les personnes compétentes, pendant tout le temps nécessaire, pour que nous nous mettions d’accord sur le sens des mots. »
Si nous suivions ce précieux conseil, nous pourrions commencer par le mot « identité ».
Et prendre tout notre temps pour le définir.
Je suis celui ou celle que je suis, évidemment. Je me montre, je parle, je m’habille tel que je suis. Et cependant, comme tout un chacun, quel que soit le chapeau que je porte, ou le voile, ou la barbe, ou l’insigne que j’ai accroché moi-même sur ma poitrine (et non pas celui que d’autres y ont fixé malgré moi), je suis un autre, je suis même plusieurs autres, qui quelquefois s’accordent et quelquefois se querellent, qui quelquefois s’épousent et parfois s’entretuent.
Ainsi, à n’en pas douter, il y a de l’arabe en moi comme en chacun de nous, même chez ceux qui disent détester les Arabes et qui les combattent. Plusieurs centaines de mots, dans la langue française, et des plus courants, à commencer par le zéro, l’algèbre, l’orange, le coton, la guitare, l’aubergine, sont des mots arabes. Même le mot harem, paraît-il.
Nous parlons quelquefois arabe sans le savoir. Nous mangeons, nous pensons arabe.
Nous l’avons peut-être oublié, ou bien même nous ne l’avons jamais remarqué, mais le mot qui revient le plus souvent dans le Coran est le mot « miséricorde », qui s’applique en priorité à Dieu lui-même, de qui il est inséparable. Et il est dit, par Ibn Arabi en particulier, que notre ennemi le plus redoutable est l’ignorance. Il y a ainsi, en nous-mêmes, si nous cherchons bien nos sources arabes, le goût de l’extase, le besoin du pardon - bienfaisant pour celui qui est pardonné, évidemment, mais surtout pour celui qui pardonne -, il y a aussi la fascination de la lettre, de l’écriture, la passion de l’étude, le besoin de la poésie - et la tentation du désert.
Toutes choses que nous trouverons ici, en n’oubliant pas la beauté.
Il est parfaitement inutile d’observer les civilisations pour les critiquer, pour les regretter ou pour les maudire. Elles sont toutes une part de nous-mêmes, imperceptible, cachée et souvent indicible. Je suis ce que je suis, ce que je crois être, mais aussi ce que je ne suis pas, ce que je n’ai jamais été, ce que je ne voudrais pas être, ce que je refuse d’être. Je suis fait de mes souvenirs comme de mes oublis. Comme de mes rejets. Je suis porteur de reflets très anciens, parfois contradictoires, et sans le savoir je les perpétue. N’en déplaise à Paul Valéry, aucune civilisation n’est mortelle.
Ainsi peut-être faut-il interpréter, dans la tradition musulmane, et plus particulièrement arabe, la prohibition de la représentation humaine, qui nous a longtemps étonnés - en précisant qu’elle ne se trouve pas dans le Coran lui-même, mais dans les Hadiths. D’un certain point de vue, que je viens d’évoquer, il est vrai que l’homme ne peut pas se représenter. À l’examiner, il est trop complexe, trop enchevêtré, trop superposé, trop fuyant. Si nous lui donnons telle ou telle forme, cet œil, ce geste, cette arme, cet habit, ou même cette parole, il devient aussitôt une anecdote, et comme le passage d’une image rapide, d’une ombre sur la Terre, que nous tenterions en vain de fixer.
Aussi, peut-être, vaut-il mieux l’oublier, ne pas lui donner une forme qui serait nécessairement mensongère. Provisoire et passagère, en tout cas. Inexacte. Une forme qui ne serait qu’une apparence.
Vite effacée, en tout cas, par le temps, qui est notre conquérant irrésistible. Car nous allons tous au hasard dans la grande forêt, comme le Petit Poucet, en laissant derrière nous des repères que d’autres, sans doute, s’efforceront bientôt de recueillir, ou de détruire.
Toute civilisation, disons-nous, est une lutte contre le temps. C’est parce qu’elle redoute cet effacement, et qu’elle le sait inévitable, qu’elle laisse mille traces aux endroits où elle est passée. En espérant que quelques unes échapperont aux loups qui rôdent dans la forêt.
La civilisation arabe, comme d’autres, a rêvé d’éternité.
Elle ne l’a pas trouvée là où elle la cherchait d’abord, dans la suprématie guerrière, dans la foi conquérante, mais il me semble, plus subtilement, plus durablement, dans les formes qu’elle a choisies, qu’elle s’est imposées, peut-être même dans les détours, dans les entrelacs de ses arabesques qui sont un mouvement de la main, mais aussi sans doute de l’esprit - je n’ose pas dire de l’âme - et qui constituent peut-être le plus secret, et aussi le plus fidèle, de nos miroirs."
Jean-Claude Carrière