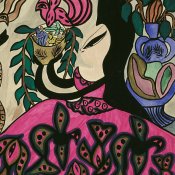Rencontre avec Yasmine Hamdan
Avant son concert à l’IMA Nord-pas-de-Calais, Yasmine Hamdan nous a accordé un moment pour parler de ses débuts à Paris, son parcours, ses rencontres, son amour pour la musique arabe et la mer et un peu de SoapKills aussi, son groupe underground formé avec son collaborateur de toujours, Zeid Hamdan, dans les années 90 ; ils portent le même patronyme mais ne partagent aucun lien de parenté. 18h03, Yasmine arrive tranquillement au lieu du rendez-vous, un café rue Montorgueil, vêtue d’une veste en blue jeans, une pomme en bouche. Rencontre...
Née en 1976 -
à Beyrouth (Liban) -
Vit et travaille à Paris depuis 2002 -
Chanteuse/Musicienne
Y.A.S, peux-tu nous raconter tes débuts à Paris ?
Je suis arrivée en 2002 et je faisais beaucoup d’allers-retours entre Paris et Beyrouth les quatre premières années. Je suis venue pour suivre des études au départ, j’ai une formation en psychologie. J’avais toujours rêvé de vivre à Paris… Je suis installée ici depuis un long moment maintenant mais je voyage énormément. Par exemple, l’année dernière j’ai voyagé plus de la moitié de l’année…
Entre Paris et Beyrouth, ton cœur balance ?
Je suis bien à Paris quand il fait chaud et beau. J’adore Paris parce que c’est vraiment une ville extraordinaire mais la mer, le soleil et la chaleur me manquent vraiment beaucoup. Je ne sais pas où il faut que j’aille dans le monde pour être bien en hiver ! (Rires). Non sérieusement, je me sens très bien à Paris ; je vais régulièrement à Beyrouth parce que j’ai ma famille, mes ami(e)s, mes habitudes… Le Liban, c’est mon pays mais c’est vrai que je ne me projette pas à Beyrouth. En revanche, j’aimerais bien avoir un pied-à-terre quelque part au soleil, la mer à proximité… Pourquoi pas la Grèce ? J’ai vécu là-bas, je parle la langue et je fantasme un peu sur ce pays mais il fait froid l’hiver…
Tu chantes en arabe (Libanais, koweïti, palestinien, égyptien et bédouin), parfois en anglais, et jamais en français… Pourquoi ?
J’ai chanté en anglais au début, j’aimerais le refaire mais je chante uniquement en arabe dans mon dernier album. Je pourrais envisager de chanter en français, je l’ai déjà fait mais c’est très compliqué pour moi de chanter dans cette langue. Je ne pourrai pas l’expliquer. Le français c’est une langue qu’il faut vraiment savoir chanter et il ne faut pas que ce soit anecdotique. Il y a énormément de chanteurs français qui m’ont inspiré tels que Brassens, Gainsbourg, Barbara, Brel à une certaine époque… J’attends d’avoir la plume pour pouvoir chanter en français. Avec Soapkills (Groupe formé avec Zeid Hamdan dans les années 90), il y a un morceau que j’ai composé en français (« Frère »), un peu rap expérimental pour m'amuser. Je l'ai essentiellement travaillé seule avec mon 4 pistes de l'époque ; Zeid est intervenu pour créer des « beats ». Ce morceau a dans l'apparence un ton sérieux ou revendicateur mais les paroles sont ironiques ; le personnage que je chante est ridicule… Ca m'avait beaucoup amusé de travailler sur ce morceau très « roots » alors c'est la démo maison qu'on a sorti, je n'ai jamais enregistré une version studio du morceau.
L’effet « Paris » sur ta pratique artistique/ta musique ?
J’ai eu l’opportunité de rencontrer des artistes formidables avec des cultures très brassées et un côté plus conceptuel dans lequel je me suis retrouvée. La ville elle-même est très inspirante. Si on garde les yeux ouverts et qu’on est curieux, on a de quoi se nourrir artistiquement et spirituellement via des écrits, des œuvres, des personnes, des musées, etc. Ce que j’ai regretté souvent c’est d’avoir parfois été stigmatisée en tant qu’artiste arabe et ça, ça ne vient pas que de la France. L’industrie musicale pourrait lire et comprendre un peu mieux un projet en arabe mais le circuit reste un peu rigide… Avec Soapkills, j’ai eu la chance d’être soutenue dès le début par des gens un peu plus avant-gardistes, par exemple Radio Nova…
Une barrière qui t’a tout de même permis d’avancer et de collaborer avec de grands talents.
Oui, ça te motive et ça te permet de te retrouver avec des gens qui ont des visions. On n’a pas forcément envie d’aller dans ton sens à un moment donné et parfois tu réalises que tu es synchro avec ton époque.
Tu as deux albums solo au compteur, Arabology avec Mirwais (ex-guitariste du groupe Taxi Girl et aux manettes de trois albums de Madonna) en 2009 et Ya Nass en collaboration avec Marc Collin (l’homme derrière Nouvelle Vague, le projet qui transformait la New Wave en Bossa Nova) en 2013. Comment ces deux personnalités ont-elles influencé ton travail ?
Les méthodes de travail étaient très différentes. J’ai rencontré Mirwais à une époque où je voulais faire quelque chose de plus électro après Soapkills ; j’avais besoin de faire une rupture et c’était un projet qui était très particulier parce que ce n’était pas moi qui le dirigeais. Donc c’était un bon exercice. Je suis passée du groupe le plus underground à un producteur qui a travaillé avec la plus grande pop star, Madonna, et c’était vraiment intéressant de faire ce grand écart.
Soapkills est né en fin de guerre civile au Liban dans un contexte où il n’y avait absolument rien ! On a joué dans plusieurs villes du monde arabe dans des situations surréalistes sur fond de coupures d’électricité et de bombardements… On ne voyait pas ça comme un drame, on vivait les choses d’une manière expérimentale, ludique, rock’n’roll, mystérieuse… Et puis nous étions pionniers du genre électro au Moyen-Orient. C’était un acte politique et social.
Je me suis mise complètement dans une autre peau en collaborant avec Mirwais et j’ai appris une nouvelle méthode de travail ; c’était un réel défi de me mettre dans une zone de inconfortable. Je n’étais pas familière aux nombreux codes de ce milieu-là et j’ai appris énormément de choses sur le tas.
Mon projet Ya Nass est né d’une envie d’album solo et je voulais une personne qui pouvait m’aider à le réaliser de la manière la plus harmonieuse possible. Je connais Marc, c’est un ami, et je savais qu’il avait beaucoup de talent et qu’il n’y aurait pas de problème d’égo entre nous. Il a très bien réagi à ce que je lui ai proposé, nous étions très « synchro ». Nous avons tout bossé ensemble ; nous nous complétions bien. Marc a une méthode de travail très rigoureuse et rapide tandis que moi, je suis très attachée aux petits détails… C’est primordial de travailler avec des gens que tu aimes, qui t’inspirent et qui sont bienveillants. Il y a des albums sublimes qui se font de façon plus antagoniste, en confrontation, mais pour ce projet-là, j’avais besoin d’harmonie. Je ne cherchais pas du tout à me violenter, j’ai préféré prendre beaucoup de plaisir à faire mon album. C’était une expérience qui m’a libérée et qui m’a fait beaucoup de bien.
De nombreuses dates en Allemagne pour ta tournée Ya Nass… As-tu des attaches particulières ?
Je commence ma tournée en France à l’IMA Nord-pas-de-Calais le 7 mai. L’album a super bien marché en Allemagne ; la presse m’a beaucoup soutenue. Mon morceau Aleb a été utilisé pour le générique de Tatort, une série télé policière allemande très populaire et je trouve ça génial que la langue n’ait pas été une barrière. Je n’ai pas été associée ni à ma race ni à la couleur de ma peau ou de mes cheveux…
Je ne suis pas arabophone et pourtant je comprends les émotions que tu transmets à travers tes morceaux...
On vit dans un monde avec tellement de frontières… Des frontières auxquelles j’ai été personnellement confrontée à cause de mon passeport libanais ou la réalité de mon pays. Mon but, depuis le début de ma carrière, est de sortir de cette logique discriminatoire. Je suis fière de prouver que la culture arabe peut être moderne et universelle, la langue arabe peut communiquer des émotions tout aussi fortes que la langue anglaise. Aujourd’hui je pense que les gens sont de plus en plus prêts à effacer certaines frontières. Personnellement je peux être touchée du plus profond de mon cœur par une chanson sans rien comprendre. On a tous appris l’anglais en chantant « yaourt » (Rires). Si tu comprends l’émotion, c’est le principal. Tu connais les Cocteau Twins ? Je donne toujours l’exemple de la chanteuse, Elisabeth Fraser, qui chantait dans une langue imaginaire et puis Sigur Ros, un groupe islandais, on ne leur a jamais demandé ce que voulait signifier leurs paroles… Il faut imaginer que ce que je raconte est quelque chose d’abstrait.
Comme une peinture à décoder…
Exactement. Quand tu regardes une peinture, tu n’as pas forcément accès à une lecture simple et unique. Tu reçois une émotion, une envie, un désir… Au final, on recherche tous des lumières ou un espoir pour se projeter, se multiplier, changer de peau ou exorciser des choses… L’art doit questionner les frontières, le sens établi et les stigmas.
Quels sont tes projets après la tournée ?
Je suis en pleine phase de pré album ; j’enregistre des choses et je m’arrête. J’attends, je me pose pleins de questions. J’ai besoin d’avoir une meilleure clairvoyance sur l’endroit où je veux aller donc je dois essayer des choses et attendre, passer par plusieurs états d’âmes. La tournée va me permettre de me confronter à un public, à des morceaux que je chantais il y a quatre ou cinq mois. Je dois les ressortir avec une nouvelle énergie et c’est très bien comme ça.
J’ai lu quelque part que l’une de tes sources d’inspiration principales était la musique arabe de 1900-1920.
J’ai trouvé des enregistrements de cette époque-là qui m’ont donné envie de chanter en arabe. Je venais d’un endroit où il n’y avait tellement rien, il fallait tout inventer, tout improviser et affronter sa famille, la pression sociale, etc. Ma prise de position est conceptuelle et politique ; en tant que femme, c’était important pour moi d’inventer ma vie et de décider de changer « mon destin ». J’étais un peu en crise identitaire, j’ai vécu partout, je me sentais « un peu chez moi et pas chez moi » à la fois partout et la musique arabe a été un peu mon coin de confort où je pouvais me réfugier et trouver de l’inspiration. C’est une musique extrêmement sophistiquée et les années 20 me fascinent et me rappellent que j’ai un côté un peu nostalgique. Donc beaucoup de chanteurs et chanteuses arabes de cette époque-là habitent la maison mais je ne les écoute pas au quotidien. J’écoute beaucoup de choses très différentes et récentes. Je passe beaucoup de temps à rechercher des morceaux de tous les coins du monde.
Tu connais Radiooooo.com , la mappemonde des sons créée par une bande de DJs parisiens en début d’année ?
Non mais je note !
Et j’ai entendu dire que tu faisais une collection de vinyles de cette même époque (1900-1920)… Tu recherches un genre musical précis ?
Pas seulement des vinyles de cette époque-là ; j’accumule beaucoup de cassettes et de mp3 du monde arabe des années 20 aux années 80... J’ai beaucoup de morceaux venant d’Egypte, du Liban, de la Syrie et du Golfe persique. J’adore tout ce qui est vieux, les mélodies m’inspirent énormément. Je fais des recherches sur YouTube aussi, quand je commence un nouvel album ; je ne compte plus les heures… Je cherche toujours à avoir une interaction avec une musique pour faire naître une envie, un désir, une idée… C’est comme si je m’exposais au soleil pour recevoir de la vitamine D de plein fouet (Rires) ; je prends beaucoup de plaisir à faire ces recherches…
Quelle est ta dernière trouvaille musicale ?
J’étais au Qatar et je me suis constituée une librairie de vieux morceaux qui sont très difficiles à trouver. Avant les concerts, j’écoute soit un album d’Abida Parveen, une chanteuse pakistanaise, soit un album très méditatif de Brian Eno, un musicien britannique…
Ton morceau Enta fen, again laisse à présager un retour imminent de SoapKills…
Non, on sort seulement un best of (Sortie le 11 mai 2015) ! Si on a le temps, l’envie et l’opportunité de faire quelques dates pour notre public qui nous a suivi depuis des années et pour lequel nous sommes vraiment importants, ce serait bien mais ce n’est pas d’actualité pour le moment. Nous sommes tous les deux très pris.
On a eu beaucoup de chance, on a vécu des moments très particuliers ; on a eu la vision de quelque chose qui n’existait pas encore mais qui pouvait exister ; la vision d’une scène alternative, d’un mode d’expression différent pour des jeunes « déracinés », qui font partie d’une génération d’après-guerre qui ont migré vers différents endroits, parfois plusieurs fois. On a tous eu des ruptures dans nos parcours. Ce groupe était une manière de m’exprimer qui me correspondait bien et je pense que beaucoup de jeunes ont pu s’identifier à cette nouvelle forme d’expression.
SoapKills, le « savon qui tue »…
C’est parti d’une blague, on était un peu hippie sur les bords. Encore une fois, Beyrouth était un endroit surréaliste et tu ne pouvais pas ne pas être hippie... Tout parlait dans cette ville, c’était une ville très émouvante, à la fois mélancolique et pleine d’espoir… Aujourd’hui elle est prête à se marier (Rires). Beyrouth était une grosse source d’inspiration pour nous. Quand la reconstruction commençait, Zeid avait écrit un morceau qui s’appelait Soap kills –le savon, c’est-à-dire, le fait de reconstruire, allait gommer les traces de guerre, les choses qui font mal, rendre le tout joli et bon… Le morceau signifiait en fait que c’était dangereux. Après on voulait chercher un nom de groupe et on a opté pour SoapKills. On avait réalisé beaucoup de petits clips en 16mm et on avait mis en scène des petits savons de Tripoli en forme de bombes. Dans l’un de ces clips, je marche dans la ville à moitié détruite et je pose ces petits savons ronds sur des socles et à la fin je monte sur un piédestal avec Beyrouth derrière ; j’ai de longs cheveux noirs, habillée en blanc… Il y a avait un petit côté post apocalyptique mais c’était fait avec drôlerie. C’était un signal pour dire « Attention, on sort de la guerre, ne nous précipitons pas ». Donc on s’est beaucoup amusé avec cette notion de « savon »…
Un petit mot sur Hal, ta performance dans le film Only Lovers Left Alive… Une anecdote de tournage… ?
J’ai rencontré le réalisateur, Jim Jarmusch, dans un festival de cinéma à Marrakech. J’ai par hasard été invitée à chanter et après le concert, il est venu me voir et m’a confié qu’il avait une idée pour moi. Il m’a envoyé le scénario et j’ai écrit le morceau Hal pour le film. C’était une expérience extraordinaire parce que c’était filmé dans la vieille ville de Tanger, une ville formidable ; on a tourné toute la nuit et il y avait une vraie symbiose, une vraie énergie magique ce soir-là avec le public. Je ne sais pas si c’était ramadan mais il y avait une atmosphère spéciale… Je me souviens d’un petit garçon de cinq ans qui se baladait tout seul dans les rues vers 2h du matin. C’était surréaliste. J’ai vraiment ressenti les débuts de quelque chose de bon là-bas…