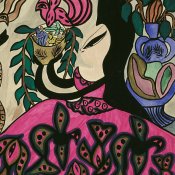Maurice Sartre, membre du conseil scientifique des RVHMA
« L'historien est aussi un citoyen »
Professeur émérite d'histoire ancienne à l'université de Tours, spécialiste de l'histoire du Proche-Orient hellénisé, Maurice Sartre est membre du conseil scientifique des Rendez-vous de l'histoire du monde arabe. Thème de la 4e édition des Rendez-vous, à l'IMA du 25 au 27 mai prochain : « Arabes, Français : quelle histoire ! » L'occasion d'interroger Maurice Sartre sur le comment et le pourquoi de l'écriture d'une histoire commune aux Français et aux Arabes. Et pour l'historien, de rappeler le rôle capital de l'érudition dans cette écriture…
Ecrire une histoire commune sert aussi à rappeler qu’on ne choisit pas plus son histoire que ses ancêtres. Une manière de récupérer la totalité de son passé – ce qui s’applique à tous.
Maurice Sartre
Vous avez récemment insisté sur la nécessité de construire une histoire qui soit commune aux Arabes et aux Français. Concrètement, comment écrire cette histoire ensemble ?
Quand je parle de construire une histoire commune, cela vaut pour les Français comme pour tous les autres : une histoire nationale ne s’écrit pas tout seul. Qu’elle mette en scène des protagonistes qui ont à la fois une longue histoire commune et une longue histoire séparée n’implique pas nécessairement d’écrire à quatre mains, avec un historien arabe et un français, mais d’abord d’écouter l’autre et de tenir compte de son point de vue – ce qui ne signifie pas qu’il ait forcément raison. Ecrire l’histoire ensemble, cela signifie : écrire une histoire qui tienne compte de celle de l’ensemble des partenaires. « On n’écrit pas l’histoire du Congo uniquement avec l’histoire des Congolais », a pu dire l’écrivain Alain Mabanckou, sous-entendant par-là que l’histoire du Congo englobe celle des colons et des colonisés. Il ne s’agit pas de se fabriquer une bonne conscience, mais bien de partager une histoire. Et pour les Arabes, cela va bien au-delà de l’histoire coloniale des pays sous tutelle de la France aux xixe-xxe siècles, ou encore de l’histoire de l’Egypte, où la France a joué un rôle très important au xixe siècle.
Mais mon propos va beaucoup plus loin : une grande partie du monde arabe est un monde méditerranéen. L’histoire de France est aussi, en grande partie, méditerranéenne. Nous partageons donc cette histoire commune qui est celle de la Méditerranée. Un univers fermé, particulier, dont les riverains sont en relation les uns avec les autres depuis la plus haute Antiquité, au moins depuis le IIe millénaire.
Cette histoire commune de tous les peuples méditerranéens, nous avons besoin de l’écrire ensemble. Concernant la période que je connais le mieux, l’Antiquité gréco-romaine, archéologues et historiens ont jusqu’à présent beaucoup insisté sur la diffusion de la culture gréco-romaine dans le monde arabe (au sens actuel), sur les différents aspects de l’hellénisation ou de la romanisation, sans guère s’inquiéter des traditions locales, qu’elles soient araméennes, égyptiennes, libyques, berbères. Il est temps d’adopter une nouvelle perspective, pour ainsi dire citoyenne.
La grande difficulté, pour les historiens, c’est d’affronter des problématiques auxquelles ils ne sont pas habitués, vers lesquelles ils ne vont pas naturellement : pour les peuples qui ont été colonisés, de quitter la posture du colonisé ; et pour un Français comme moi, héritier direct de l’Empire romain, de quitter une posture malgré tout coloniale ou post-coloniale.
A l’inverse, aux historiens issus du monde arabe actuel de ne pas se poser des questions uniquement en terme de traditions indigènes : les Syriens essaient de trouver des Arabes jusqu’au IIe voire IIIe millénaire avant notre ère. Mais que la civilisation grecque et romaine leur a-t-elle apporté et transmis ? Et quid du rôle des Arabes et des Araméens dans la transmission ?
Nous avons tous été horrifiés par les destructions perpétrées par Daech en Syrie et en Irak ; c’est oublier une tradition vieille de dizaines d’années évacuant, en Syrie, tout ce qui est non-arabe. Que l’on affiche publiquement et enseigne dans les manuels que la période gréco-romaine, assimilée aux colonisations, est « l’une des plus sombres de l’histoire de la Syrie », que les Syriens sont tous des descendants des combattants de Mahomet : voilà qui les invite à occulter toute une partie de leur histoire comme si ce n’était pas leur histoire.
Ecrire une histoire commune sert aussi à cela : rappeler qu’on ne choisit pas plus son histoire que ses ancêtres. Une manière de récupérer la totalité de son passé – ce qui s’applique à tous.
L’historien est aux antipodes du poète, qui écrit des œuvres closes, auxquelles on ne touchera plus. L’historien n’écrit pas pour l’éternité. Il est périssable.
Maurice Sartre
Vous avez dit : « Je crois que l’érudition est le fondement de tout, et il ne faut pas en avoir honte »…
Oui, pour moi, la solution, c’est l’érudition. Les historiens sont confrontés à ce problème permanent qu’est le poids de l’idéologie – voyez les tentatives de contrôle, par les politiques, de l’enseignement de l’histoire et du « roman national » ; encore que, en France, la défense à tous crins des Gaulois ne soit plus guère de mise. Actuellement, la difficulté est qu’un grand nombre de pays arabes vivent sous des régimes dictatoriaux. Or, il n’y a pas de liberté de pensée dans un régime dictatorial mais une idéologie qui s’impose à tous : un historien syrien ne peut pas écrire ce qu’il veut.
Une solution existe : prendre appui sur l’érudition. C’est grâce à l’érudition que s’écrit l’histoire, grâce à la connaissance des documents. Un exemple concret : pour écrire l’histoire de Zénobie de Palmyre, on se fonde notamment sur des monnaies, lesquelles portent pour légende : Zenobia Augusta, Zénobie impératrice (de Rome nécessairement puisque l’inscription est en latin). Mais l’idéologue postule que Zénobie est arabe, et qu’elle ne peut avoir fait la guerre que pour libérer son peuple du joug romain… alors qu’elle a pris le contrôle des troupes romaines de Syrie et s’est proclamée impératrice !
La seule solution, pour écrire une histoire partagée, notre histoire commune, c’est de repartir de la base, en se fondant sur l’ensemble des documents : un travail exigeant, qui nécessite de maîtriser la documentation, de savoir lire les sources anciennes, interpréter la documentation numismatique, papyrologique, archéologique, etc. L’érudition est à ce prix.
Vous avez également dit que « La synthèse, c’est la tentative indispensable et impossible d’une explication globale ». Il serait donc impossible d’écrire cette histoire sans en sacrifier un ou plusieurs pans ?
N’en tirez surtout pas la conclusion qu’il est inutile d’écrire des livres de synthèse puisqu’on n’y arrivera pas ! Les synthèses sont indispensables, d’abord pour celui qui les écrit : c’est la seule façon qu’a un historien de savoir où il en est à un moment donné et sur une question donnée la plus large possible. Ecrire une synthèse lui permet de soulever des questions qu’il avait négligées jusqu’alors, ou traitées d’une façon qui lui paraît superficielle, et c’est aussi de cette façon que son point de vue peut évoluer. Surtout, les synthèses sont indispensables pour les étudiants, les collègues non spécialistes du domaine et pour le grand public. Les historiens ont aussi pour mission de faire avancer la connaissance. J’ai parlé de tentative « impossible » car jamais aucun historien, par la seule magie de l’écriture, ne restituera la totalité de la connaissance historique. Ce qui n’empêche pas d’écrire des biographies qui sont des formes de synthèse, même en présence de lacunes gigantesques.
Lorsque, en 2001, j’ai publié D’Alexandre à Zénobie. Histoire du Levant antique (IVe s. av.-IIIe s. ap. J.-C.), certains de mes collègues, notamment anglo-saxons, assuraient qu’on ne pouvait rien écrire sur l’histoire de la Syrie hellénistique ; et pourtant, il y avait à écrire ! Différentes catégories de documents avaient été jusque-là laissés de côté telles que les céramiques, les amphores notamment ; il fallait faire la synthèse des rapports de fouilles. La documentation ne cesse de croître, des champs vierges commencent à être documentés. Des éléments nouveaux apparaissent qui changent l’image qu’on se faisait de tel ou tel problème. Une synthèse réécrite à cinquante ans de distance sera différente de la précédente – qui aura eu du moins l’utilité de stimuler le désir de la dépasser.
L’historien est aux antipodes du poète, qui écrit des œuvres closes, auxquelles on ne touchera plus. L’historien n’écrit pas pour l’éternité. Il est périssable.
Le module « Ma thèse en cinq minutes » vous tient particulièrement à cœur. Soutenir une thèse est-il toujours indispensable aujourd’hui ?
Je suis attaché au module « Ma thèse en cinq minutes », car c’est un exercice très intéressant. Il apprend aux chercheurs, qui sont immergés dans l’érudition la plus pointue, à effectuer une synthèse de leurs travaux dans une langue claire et compréhensible par tous. La thèse est une étape importante, mais les jeunes chercheurs doivent comprendre qu’ils ont aussi un devoir de diffusion de leurs connaissances.
Par ailleurs, les thèses ont souvent ouvert des pistes neuves, à l’occasion d’un fond d’archive nouveau, de croisements pas encore effectués. La thèse est faite pour déporter le regard là on ne l’avait pas, ou peu, porté jusqu’alors.
La thèse, par la puissance de l’érudition justement, est le seul moyen de remettre en cause les vérités établies ou les idées reçues. Une manière de les combattre, de modifier le regard qu’on porte sur une documentation. L’historien est aussi le témoin de son temps. Pourquoi la démocratie, qui nous paraissait une conquête indispensable il y a un demi-siècle, est-elle aujourd’hui menacée de périr sous les coups de ses adversaires ? Le questionnement est permanent entre l’Antiquité et aujourd’hui.
L’historien est aussi un citoyen.