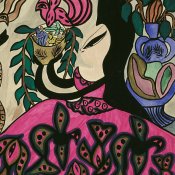Entretien avec Ernest Pignon-Ernest
Un hommage à Vladimir Veličković [1935-2019]
L’exposition « Couleurs du monde. Collections du musée d'art moderne et contemporain de la Palestine », à l'IMA du 15 septembre au 20 décembre 2020, est l’occasion d’un hommage au peintre Vladimir Veličković. Disparu le 29 août 2019, il fut l’un des tout premiers artistes à avoir cru à la réalité de ce musée. Entretien avec Ernest Pignon-Ernest, à l’origine avec Élias Sanbar du futur Musée palestinien, qui fut son ami et compagnon en art.
Cette tragédie qu’exprimait Veličković porte en elle une dimension presque métaphysique. Au fond, il s’agissait d’une représentation de la Passion, comme aurait pu le faire un chrétien, de la violence faite au corps humain.
Ernest Pignon-Ernest
Comment vous êtes-vous rencontrés, Vladimir Veličković et vous ?
Nous nous étions rencontrés bien avant la création de la collection du futur Musée d’art moderne et contemporain de la Palestine : de la même manière que j’accompagne l’exposition du musée palestinien et l’enrichissement de ses collections, j’ai eu dans les années 1980 la responsabilité de l’exposition « Artistes du monde contre l’apartheid ». Là encore, nous avions créé un musée [le « Musée de l’exil », un musée itinérant qui circula dans des dizaines de pays jusqu’à l’abolition de la ségrégation en Afrique du Sud, en 1991] ; et Veličković, de la même manière que pour le musée de la Palestine, avait été l’un des premiers à donner un grand tableau. Dans les statuts, il était spécifié que les œuvres appartiendraient au premier gouvernement démocratique d’Afrique du Sud. C’est ainsi que Veličković et moi-même avons rencontré Nelson Mandela ensemble.
Mais je le connaissais de plus longue date : lorsque je suis arrivé à Paris, j’ai découvert ses œuvres et j’ai cherché à le rencontrer. Nous nous sommes très vite découvert des affinités et avons réalisé que nous menions des recherches du même ordre ; une estime, réciproque je crois, une amitié est née.
C’était un virtuose, un très grand peintre, il portait en lui une manière de souffrance, de tragédie. Il était un peu plus âgé que moi ; enfant, il avait assisté à des scènes très violentes perpétrées par les nazis dans son pays, la Yougoslavie. Et toute sa vie, il a été porté par cela, puis par l’éclatement de son pays. Nous avons donc partagé beaucoup de choses, dont la condamnation de l’apartheid. Dans nos œuvres, il y a la même interrogation sur la représentation du corps humain et sur ce qu’on lui a infligé, ce qu’on lui inflige comme souffrances ; sur les violences que l’homme inflige à l’homme.
Ses œuvres, comme les vôtres, sont pleines des effrois du monde. Mais cela transparaissait-il dans l’homme ?
Il a dessiné des fleurs… mais avec la même plume ! Cependant, cette tragédie qu’il exprimait porte en elle une dimension presque métaphysique, ce n’est pas une représentation politique au premier degré. Au fond, il s’agissait d’une représentation de la Passion, comme aurait pu le faire un chrétien, de la violence faite au corps humain. Il a par exemple travaillé des années sur le retable d’Issenheim et sur Grünewald.
C’était un bel homme, très vivant, qui jouait régulièrement au tennis avec son fils, s’intéressait au sport… Un ami agréable, en somme ! Mais il portait cette souffrance en lui. J’ai participé un jour à un débat sur le dessin avec lui et avec Enki Bilal, l’auteur de bande dessinée. Le modérateur les a invités à se présenter, et tous deux ont répondu : Yougoslave, alors que leur pays avait éclaté depuis des années. Au fond, son œuvre, c’est une espèce de cicatrice dans la mémoire. Mais il ne faut pas s’arrêter au thème. L’essentiel, c’était la spécificité de la peinture ; Veličković était avant tout un grand peintre. Ce qu’il a interrogé, c’est aussi la peinture elle-même.
Quelle image voudriez-vous que l’on garde de lui ?
Je voudrais que l’on dise son humanité, cette fraternité avec l’homme. Son énergie, son exigence. C’était un homme de rigueur. Un temps, sa peinture n’a pas été à la mode, mais il n’a jamais fait la moindre concession.
Pour en revenir à la Palestine, il a donc offert un tableau aux Palestiniens, eux dont certains voudraient que leur pays n’existe plus – la négation totale, comme pour le village natal de Mahmoud Darwich, dont il n’y a plus trace : on l’a complètement fait disparaître, comme s’il n’avait jamais existé.
Or, Vlada – c’est comme ça qu’on l’appelait – avait titré l’une de ses expositions : « À mon pays qui n’existe plus ». Face à ces Palestiniens dont on essaie de nier le pays, c’est de cette phrase que je me souviens…